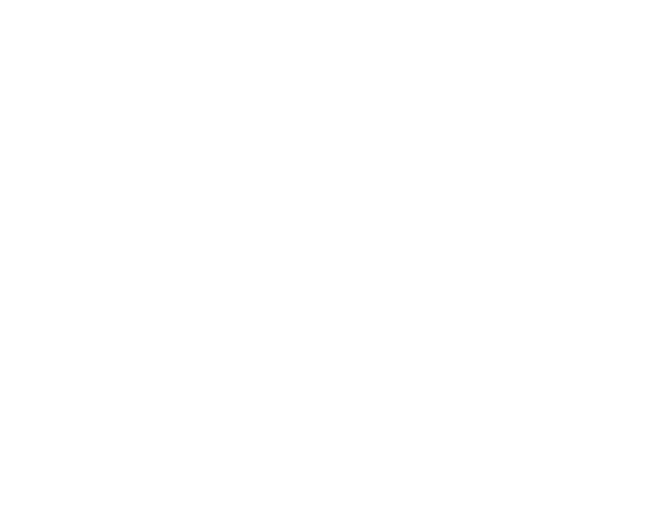Dans un rapport rendu public à l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC, la Cour des comptes passe au crible la politique de santé publique consacrée à cette pathologie. En 2022, quelque 120 000 personnes ont été victimes d’un AVC.
Selon la CNAM, la dépense concernant les AVC s’élève à 4,162 Mds € (dépenses hospitalières, soins de ville et prestations en espèces). Les Sages de la rue Cambon ont réévalué ce chiffre en y ajoutant la dépense médico-sociale, et estiment à environ 4,5 Mds € le coût total pour la prise en charge des patients victimes d’AVC. Avec près de 30 000 décès par an (dont 58 % de femmes), ils constituent la première cause de décès cardio-vasculaires chez la femme, et la seconde chez l’homme.
La Cour estime que la prévention primaire «rencontre d’importantes limites». Le contrôle de l’hypertension n’a pas constitué une priorité, malgré les recommandations du plan AVC 2010-204 et alors qu’il s’agit du principal facteur de risque. La juridiction financière recommande un plan d’action dédié à la lutte contre l’hypertension ainsi qu’un meilleur ciblage et une intensification des actions de prévention sur les publics les plus à risque. L’information reste également à «poursuivre et intensifier» et «gagnerait» à s’inscrire dans une stratégie nationale.
Par ailleurs, si l’objectif de 140 Unités neuro-vasculaire (UNV) fixé par le plan AVC a été atteint, il «ne répond plus à l’ensemble des besoins aujourd’hui identifiés par les ARS et la communauté professionnelle neurovasculaire». Par ailleurs, des progrès sont relevés, mais les résultats obtenus «restent en deçà des objectifs visés ou des résultats escomptés, notamment en termes de délais de prise en charge ou d’accès aux unités neuro-vasculaires». L’offre de soins apparaît inégalement répartie sur le territoire, avec une filière fragilisée par les difficultés de recrutement médical et paramédical. La Cour suggère de développer le télé-AVC entre UNV et établissements de santé de proximité. Elle recommande également d’élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la filière neurovasculaire.
La Cour pointe également «une filière post-aiguë mal articulée avec la phase aiguë, n’assurant pas un accompagnement effectif des patients». Ainsi, la programmation d’une consultation post-AVC n’est conforme que pour 60 % des patients, le suivi nutritionnel et pondéral pour 72 % et l’appui pour l’élaboration d’un projet de vie l’est à 57 %. Elle relève également le «manque d’efficacité» du parcours patient dans son ensemble.